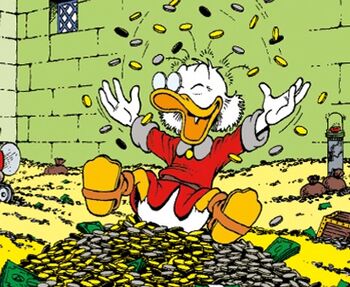Texte 10
Disons plutôt qu’il faut comparer le choix moral avec la construction d’une œuvre d’art. Et ici, il faut tout de suite faire une halte pour bien dire qu’il ne s’agit pas d’une morale esthétique, car nos adversaires sont d’une si mauvaise foi qu’ils nous reprochent même cela. L’exemple que j’ai choisi n’est qu’une comparaison. Ceci dit, a-t-on jamais reproché à un artiste qui fait un tableau de ne pas s’inspirer des règles établies a priori ?A-t-on jamais dit quel est le tableau qu’il doit faire ? Il est bien entendu qu’il n’y a pas de tableau défini à faire, que l’artiste s’engage dans la construction de son tableau, et que le tableau à faire c’est précisément le tableau qu’il aura fait ; il est bien entendu qu’il n’y a pas de valeurs esthétiques a priori, mais qu’il y a des valeurs qui se voient ensuite dans la cohérence du tableau, dans les rapports qu’il y a entre la volonté de création et le résultat. Personne ne peut dire ce que sera la peinture de demain ; on ne peut juger la peinture qu’une fois faite. Quel rapport cela a-t-il avec la morale ? Nous sommes dans la même situation créatrice. Nous ne parlons jamais de la gratuité d’une œuvre d’art. Quand nous parlons d’une toile de Picasso, nous ne disons jamais qu’elle est gratuite ; nous comprenons très bien qu’il s’est construit tel qu’il est en même temps qu’il peignait, que l’ensemble de son œuvre s’incorpore à sa vie. Il en est de même sur le plan moral. Ce qu’il y a de commun entre l’art et la morale, c’est que, dans les deux cas, nous avons création et invention. Nous ne pouvons pas décider a priori de ce qu’il y a à faire. Je crois vous l’avoir assez montré en vous parlant du cas de cet élève qui est venu me trouver et qui pouvait s’adresser à toutes les morales, kantienne ou autres, sans y trouver aucune espèce d’indication ; il était obligé d’inventer sa loi lui-même. Nous ne dirons jamais que cet homme, qui aura choisi de rester avec sa mère en prenant comme base morale les sentiments, l’action individuelle et la charité concrète, ou qui aura choisi de s’en aller en Angleterre, en préférant le sacrifice, a fait un choix gratuit. L’homme se fait ; il n’est pas tout fait d’abord, il se fait en choisissant sa morale, et la pression de circonstances est telle qu’il ne peut pas ne pas en choisir une. Nous ne définissons l’homme que par rapport à un engagement. Il est donc absurde de nous reprocher la gratuité du choix.
En second lieu, on nous dit : vous ne pouvez pas juger les autres. C’est vrai dans une mesure, et faux dans une autre. Cela est vrai en ce sens que, chaque fois que l’homme choisit son engagement et son projet en toute sincérité et en toute lucidité, quel que soit par ailleurs ce projet, il est impossible de lui en préférer un autre ; c’est vrai dans ce sens que nous ne croyons pas au progrès ; le progrès est une amélioration ; l’homme est toujours le même en face d’une situation qui varie et le choix reste toujours un choix dans une situation. Le problème moral n’a pas changé depuis le moment où l’on pouvait choisir entre les esclavagistes et les non-esclavagistes, par exemple au moment de la guerre de Sécession, et le moment présent où l’on peut opter pour le M.R.P. ou pour les communistes.
Mais on peut juger, cependant, car, comme je vous l’ai dit, on choisit en face des autres, et on se choisit en face des autres. On peut juger, d’abord (et ceci n’est peut-être pas un jugement de valeur, mais c’est un jugement logique), que certains choix sont fondés sur l’erreur, et d’autres sur la vérité. On peut juger un homme en disant qu’il est de mauvaise foi. Si nous avons défini la situation de l’homme comme un choix libre, sans excuses et sans secours, tout homme qui se réfugie derrière l’excuse de ses passions, tout homme qui invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi. On objecterait : mais pourquoi ne se choisirait-il pas de mauvaise foi ? Je réponds que je n’ai pas à le juger moralement, mais je définis sa mauvaise foi comme une erreur. Ici, on ne peut échapper à un jugement de vérité. La mauvaise foi est évidemment un mensonge, parce qu’elle dissimule la totale liberté de l’engagement. Sur le même plan, je dirai qu’il y a aussi mauvaise foi si je choisis de déclarer que certaines valeurs existent avant moi ; je suis en contradiction avec moi-même si, à la fois, je les veux et déclare qu’elles s’imposent à moi. Si l’on me dit : et si je veux être de mauvaise foi ? je répondrai : il n’y a aucune raison pour que vous ne le soyez pas, mais je déclare que vous l’êtes, et que l’attitude de stricte cohérence est l’attitude de bonne foi. Et en outre je peux porter un jugement moral. Lorsque je déclare que la liberté, à travers chaque circonstance concrète, ne peut avoir d’autre but que de se vouloir elle-même, si une fois l’homme a reconnu qu’il pose des valeurs dans le délaissement, il ne peut plus vouloir qu’une chose, c’est la liberté comme fondement de toutes les valeurs. Cela ne signifie pas qu’il la veut dans l’abstrait. Cela veut dire simplement que les actes des hommes de bonne foi ont comme ultime signification la recherche de la liberté en tant que telle. Un homme qui adhère à tel syndicat, communiste ou révolutionnaire, veut des buts concrets ; ces buts impliquent une volonté abstraite de liberté ; mais cette liberté se veut dans le concret.
10- Il n’y a pas d’acte gratuit
- Cherchez le sens du terme « gratuit » dans le contexte (« il a fait un choix gratuit »)
- Quelle similitude Sartre remarque-t-il ici entre art et morale ?

Picasso, Femme qui pleure
Texte 11
- Nous voulons la liberté pour la liberté et à travers chaque circonstance particulière. Et en voulant la liberté, nous découvrons qu’elle dépend entièrement de la liberté des autres, et que la liberté des autres dépend de la nôtre. Certes, la liberté comme définition de l’homme ne dépend pas d’autrui, mais dès qu’il y a engagement, je suis obligé de vouloir en même temps que ma liberté la liberté des autres, je ne puis prendre ma liberté pour but que si je prends également celle des autres pour but. En conséquence, lorsque, sur le plan d’authenticité totale, j’ai reconnu que l’homme est un être chez qui l’essence est précédée par l’existence, qu’il est un être libre qui ne peut, dans des circonstances diverses, que vouloir sa liberté, j’ai reconnu en même temps que je ne peux vouloir que la liberté des autres. Ainsi, au nom de cette volonté de liberté, impliquée par la liberté elle-même, je puis former des jugements sur ceux qui visent à se cacher la totale gratuité de leur existence, et sa totale liberté. Les uns qui se cacheront, par l’esprit de sérieux ou par des excuses déterministes, leur liberté totale, je les appellerai lâches ; les autres qui essaieront de montrer que leur existence était nécessaire, alors qu’elle est la contingence même de l’apparition de l’homme sur la terre, je les appellerai des salauds. Mais lâches ou salauds ne peuvent être jugés que sur le plan de la stricte authenticité. Ainsi, bien que le contenu de la morale soit variable, une certaine forme de cette morale est universelle. Kant déclare que la liberté veut elle-même et la liberté des autres. D’accord, mais il estime que le formel et l’universel suffisent pour constituer une morale. Nous pensons, au contraire, que des principes trop abstraits échouent pour définir l’action. Encore une fois, prenez le cas de cet élève ; au nom de quoi, au nom de quelle grande maxime morale pensez-vous qu’il aurait pu décider en toute tranquillité d’esprit d’abandonner sa mère ou de rester avec elle ? Il n’y a aucun moyen de juger. Le contenu est toujours concret, et par conséquent imprévisible ; il y a toujours invention. La seule chose qui compte, c’est de savoir si l’invention qui se fait, se fait au nom de la liberté.
Examinons, par exemple, les deux cas suivants, vous verrez dans quelle mesure ils s’accordent et cependant diffèrent. Prenons Le Moulin sur la Floss. Nous trouvons là une certaine jeune fille, Maggie Tulliver, qui incarne la valeur de la passion et qui en est consciente ; elle est amoureuse d’un jeune homme, Stephen, qui est fiancé à une jeune fille insignifiante. Cette Maggie Tulliver, au lieu de préférer étourdiment son propre bonheur, au nom de la solidarité humaine choisit de se sacrifier et de renoncer à l’homme qu’elle aime. Au contraire, la Sanseverina, dans La Chartreuse de Parme, estimant que la passion fait la vraie valeur de l’homme, déclarerait qu’un grand amour mérite des sacrifices ; qu’il faut le préférer à la banalité d’un amour conjugal qui unirait Stephen et la jeune oie qu’il devait épouser ; elle choisirait de sacrifier celle-ci et de réaliser son bonheur ; et, comme Stendhal le montre, elle se sacrifiera elle-même sur le plan passionné si cette vie l’exige. Nous sommes ici en face de deux morales strictement opposées ; je prétends qu’elles sont équivalentes : dans les deux cas, ce qui a été posé comme but, c’est la liberté. Et vous pouvez imaginer deux attitudes rigoureusement semblables quant aux effets : une fille, par résignation, préfère renoncer à un amour, une autre, par appétit sexuel, préfère méconnaître les liens antérieurs de l’homme qu’elle aime. Ces deux actions ressemblent extérieurement à celles que nous venons de décrire. Elles en sont, cependant, entièrement différentes ; l’attitude de la Sanseverina est beaucoup plus près de celle de Maggie Tulliver que d’une rapacité insouciante.
Ainsi vous voyez que ce deuxième reproche est à la fois vrai et faux. On peut tout choisir si c’est sur le plan de l’engagement libre.
11- La liberté des autres
a) Notre liberté dépend-elle de celle des autres ?
b) Qu’est-ce qu’un lâche selon lui ?
c) Au nom de quoi puis-je juger autrui ?

Texte 12
La troisième objection est la suivante : vous recevez d’une main ce que vous donnez de l’autre ; c’est-à-dire qu’au fond les valeurs ne sont pas sérieuses, puisque vous les choisissez. A cela je réponds que je suis bien fâché qu’il en soit ainsi ; mais si j’ai supprimé Dieu le père, il faut bien quelqu’un pour inventer les valeurs. Il faut prendre les choses comme elles sont. Et, par ailleurs, dire que nous inventons les valeurs ne signifie pas autre chose que ceci : la vie n’a pas de sens, a priori. Avant que vous ne viviez, la vie, elle, n’est rien, mais c’est à vous de lui donner un sens, et la valeur n’est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Par là vous voyez qu’il y a possibilité de créer une communauté humaine. On m’a reproché de demander si l’existentialisme était un humanisme. On m’a dit : mais vous avez écrit dans La Nausée que les humanistes avaient tort, vous vous êtes moqué d’un certain type d’humanisme, pourquoi y revenir à présent ? En réalité, le mot humanisme a deux sens très différents. Par humanisme on peut entendre une théorie qui prend l’homme comme fin et comme valeur supérieure. Il y a humanisme dans ce sens chez Cocteau, par exemple, quand dans son récit, Le Tour du monde en 80 heures, un personnage déclare, parce qu’il survole des montagnes en avion : l’homme est épatant. Cela signifie que moi, personnellement, qui n’ai pas construit les avions, je bénéficierais de ces inventions particulières, et que je pourrais personnellement, en tant qu’homme, me considérer comme responsable et honoré par des actes particuliers à quelques hommes. Cela supposerait que nous pourrions donner une valeur à l’homme d’après les actes les plus hauts de certains hommes. Cet humanisme est absurde, car seul le chien ou le cheval pourraient porter un jugement d’ensemble sur l’homme et déclarer que l’homme est épatant, ce qu’ils n’ont garde de faire, à ma connaissance tout au moins. Mais on ne peut admettre qu’un homme puisse porter un jugement sur l’homme. L’existentialisme le dispense de tout jugement de ce genre : l’existentialiste ne prendra jamais l’homme comme fin, car il est toujours à faire. Et nous ne devons pas croire qu’il y a une humanité à laquelle nous puissions rendre un culte, à la manière d’Auguste Comte. Le culte de l’humanité aboutit à l’humanisme fermé sur soi de Comte, et, il faut le dire, au fascisme. C’est un humanisme dont nous ne voulons pas.
Mais il y a un autre sens de l’humanisme, qui signifie au fond ceci : l’homme est constamment hors de lui-même, c’est en se projetant et en se perdant hors de lui qu’il fait exister l’homme et, d’autre part, c’est en poursuivant des buts transcendants qu’il peut exister ; l’homme étant ce dépassement et ne saisissant les objets que par rapport à ce dépassement, est au cœur, au centre de ce dépassement. Il n’y a pas d’autre univers qu’un univers humain, l’univers de la subjectivité humaine. Cette liaison de la transcendance, comme constitutive de l’homme – non pas au sens où Dieu est transcendant, mais au sens de dépassement -, et de la subjectivité, au sens où l’homme n’est pas enfermé en lui-même mais présent toujours dans un univers humain, c’est ce que nous appelons l’humanisme existentialiste. Humanisme, parce que nous rappelons à l’homme qu’il n’y a d’autre législateur que lui-même, et que c’est dans le délaissement qu’il décidera de lui-même ; et parce que nous montrons que ça n’est pas en se retournant vers lui, mais toujours en cherchant hors de lui un but qui est telle libération, telle réalisation particulière, que l’homme se réalisera précisément comme humain.
On voit, d’après ces quelques réflexions, que rien n’est plus injuste que les objections qu’on nous fait. L’existentialisme n’est pas autre chose qu’un effort pour tirer toutes les conséquences d’une position athée cohérente. Il ne cherche pas du tout à plonger l’homme dans le désespoir. Mais si l’on appelle comme les chrétiens, désespoir, toute attitude d’incroyance, il part du désespoir originel.
L’existentialisme n’est pas tellement un athéisme au sens où il s’épuiserait à démontrer que Dieu n’existe pas. Il déclare plutôt : même si Dieu existait, ça ne changerait rien ; voilà notre point de vue. Non pas que nous croyions que Dieu existe, mais nous pensons que le problème n’est pas celui de son existence ; il faut que l’homme se retrouve lui-même et se persuade que rien ne peut le sauver de lui-même, fût-ce une preuve valable de l’existence de Dieu. En ce sens, l’existentialisme est un optimisme, une doctrine d’action, et c’est seulement par mauvaise foi que, confondant leur propre désespoir avec le nôtre, les chrétiens peuvent nous appeler désespérés
12- L’existentialisme est un humanisme
a- Quel sens du mot « humanisme » Sartre refuse-t-il ?
b- En quel sens Sartre affirme-t-il que l’existentialisme est pourtant un humanisme ?