L’échange marchand est-il suffisant pour fonder le lien social ?
Société : au sens le plus large : tout ensemble d’individus dans lequel on constate des services réciproques : intérêts alimentaires, reproductifs, défense /ennemis.
Toute société est donc basée sur l’échange de biens et de service en vue de la survie.
Mais cette définition du lien social n’est-elle pas trop restrictive ? L’échange n’est pas seulement lié aux nécessités matérielles. Il nous faut donc analyser les diverses dimensions de l’échange en fonction de son impact sur le lien social.
I- Travail, échange et lien social
A- Des sociétés sans individus aux sociétés individualistes
Des sociétés sans « individus, sans Etat
On nomme ces sociétés : sociétés holistes, autrement dit dans ces sociétés le tout prime sur les individus. Le Tout est plus que la somme des parties.

Les sociétés holistes sont souvent sans Etat et se caractérisent par l’absence d’individuation, d’autonomie des membres de la communauté : sociétés indivises, sans individualité, sans individus.
Dans certaines sociétés indiennes d’Amérique du sud : Existence d’un chef sans pouvoir décisionnel, d’une société sans hiérarchisation ou domination. Le chef n’a qu’une fonction diplomatique, celle de parler au nom de la communauté.
Ces sociétés sont des sociétés sans division, sans classe, sans pouvoir individuel central et séparé, donc sans Etat. Stables et d’évolution très lente, elles n’ont pas de dimension historique, pas d’écriture. Avant le Moyen-Age, l’individu ne possédait pas d’identité propre. (les sculpteurs des cathédrales, les peintres…)
Au sein de la société chrétienne, l’homme n’est pas en relation immédiate avec lui‑même. Il explique sa situation par tout ce qui dépasse le personnel et l’individuel.
Nous sommes définis par le groupe social avant de nous définir comme individu
Formation de la notion d’individualité
La notion d’individu n’a rien d’évident ni de premier. Elle est le fruit d’un long travail historique, débuté sous l’Antiquité, repris par les théologiens du Moyen Age et achevé lors de la Réforme et de la Renaissance.
La Renaissance a finalement rompu avec cette conception holiste de la société et de la personnalité. Puis les Lumières ont valorisé l’individu en tant qu’être distinct ‑ non soumis aux contraintes des groupes familiaux et sociaux qui encadraient sa vie ‑ et protégé par des règles juridiques écrites. L’avènement de l’économie marchande a achevé ce processus.

L’individu et la personne, constituent l’une des originalités les plus fortes de la philosophie et de la civilisation occidentales.
La société moderne, une somme d’individus
Individu : désigne principalement un être vivant possédant une unité intérieure (conscience), doté d’une certaine autonomie par rapport au tout dans lequel il évolue.
Individu : in- divis, qu’on ne peut diviser. Cela réfère à l’unité de la conscience. Un individu est aussi un élément radicalement séparé, isolé du reste. Autrement dit, c’est un être indépendant et autonome, ayant des intérêts et des droits qui peuvent être en opposition avec ceux de la société et de l’espèce (dictionnaire Hatier).
L’approche sociologique, écrit Lalande, considère l’individu comme « l’unité dont se compose les sociétés ». La sociabilité est considérée comme seconde par rapport à l’individualité. Donc une société moderne c’est: je+je+je…
La société n’est alors rien de plus qu’un agrégat d’individus liés ensemble par leurs intérêts propres.

B- Division sociale des tâches et échanges marchands
Partage progressif du travail, spécialisation progressive des tâches depuis le néolithique.
Platon est un des premiers philosophes à avoir remarqué qu’au niveau de la société
« on fait plus et mieux et plus aisément, lorsque chacun ne fait qu’une chose, celle à laquelle il est propre ».
Texte 1
En analysant, dans La République, la formation de la Cité, Platon décrit le regroupement volontaire d’individus ayant des besoins à satisfaire, mais ne pouvant tous les satisfaire eux-mêmes, tels que se nourrir, se vêtir, se loger, qui nécessitent différents savoirs pour labourer, tisser les vêtements, ou encore bâtir les édifices. C’est de la nécessité de satisfaire ses besoins que l’homme seul ne peut satisfaire, qu’est née la Cité; Cité qui se caractérise donc avant tout par cette organisation du travail.
C- Le commerce remplace la guerre
Un moyen d’appropriation légitime du bien d’autrui serait le commerce, l’échange marchand. En effet, on peut s’approprier illégitimement le bien d’autrui par la force, la guerre, mais il est plus intéressant de se l’approprier de gré à gré.

« La guerre est antérieure au commerce ; car la guerre et le commerce ne sont que deux moyens différents d’atteindre le même but : celui de posséder ce que l’on désire. Le commerce n’est qu’un hommage rendu à la force du possesseur par l’aspirant à la possession. C’est une tentative pour obtenir de gré à gré ce qu’on n’espère plus conquérir par la violence. Un homme qui serait toujours le plus fort n’aurait jamais l’idée du commerce. C’est l’expérience qui, en lui prouvant que la guerre, c’est-à-dire l’emploi de sa force contre la force d’autrui, l’expose à diverses résistances et à divers échecs, le porte à recourir au commerce, c’est-à-dire à un moyen plus doux et plus sûr d’engager l’intérêt d’un autre à consentir à ce qui convient à son intérêt. La guerre est l’impulsion, le commerce est le calcul. Mais par là même il doit venir une époque où le commerce remplace la guerre. Nous sommes arrivés à cette époque ».
Benjamin Constant- De la liberté des anciens comparée à celle des modernes
1- En quoi les arguments de Benjamin Constant légitiment-ils l’échange marchand ? Comment décrit-il les sociétés avant l’apparition du commerce ? Peut-on lui donner raison sur ce point ?
II- L’individualisme et l’égoïsme au fondement de l’égalité de l’échange ?
L’égoïsme semble dans nos sociétés être au fondement de l’échange. Mais cet égoïsme entraîne paradoxalement la création d’un lien social, la recherche de l’égalité, de la justice et la priorité donnée à l’intérêt commun.
A- Contractualité de l’échange
L’échange est un contrat implicite ou explicite entre deux parties, puisque il se déroule:
- Avec le consentement mutuel des participants, donc entre des personnes libres, qui échangent de gré à gré
- entre deux sujets conscients et dotés de raison: capables de tenir une promesse (si tu me donnes ceci, je te promets de te donner cela)
- Qui donc ne se mentent pas et s’engagent dans un rapport réciproque.
- Chacun y trouve son compte, sert son propre intérêt.
Quand un échange a lieu, les deux partis font une bonne affaire.
Lors d’un échange, la valeur d’échange exprimée par le prix est toujours inférieure à la valeur d’usage du demandeur et toujours supérieure à la valeur d’usage de l’offreur. Par exemple, si j’ai faim et que j’achète une baguette de pain à un euro, c’est que de mon point de vue la baguette achetée vaut plus qu’un euro (sinon je ne l’aurais pas acheté). La pièce d’un euro m’est à ce moment là moins utile que la baguette pour satisfaire mes besoins. Pour le boulanger en revanche, la baguette de pain vaut moins qu’un euro (sinon il ne l’aurait pas vendu, ou aurait augmenté le prix).
Conséquence :
c’est la confrontation de deux intérêts privés qui amène l’égalité de l’échange.
Paradoxalement, l’échange fonctionne donc selon deux principes qui semblent opposés: égoïsme et égalité !
Sociétés individualistes, égalitaristes et échanges marchands vont de pair.
B- Monnaie et égalité
Comment échanger des objets qui n’ont rien en commun, une maison et une chaussure ? Il faut rendre commensurables ces deux produits, c’est-à-dire leur donner une grandeur mathématique commune. La solution géniale est l’invention de la monnaie d’échange. C’est la monnaie qui rend possible la commensurabilité des objets au niveau de leur valeur d’échange.Conséquence : création d’une communauté d’intérêts entre des hommes produisant des biens de valeur très différente.
Texte
Aristote , Ethique à Nicomaque
III- L’échange marchand suffit-il à fonder le lien social ?
A- Perversion de l’échange: la chrématistique
Aristote (384-322 av. J.C.) fut le premier à montrer que l’argent, moyen commode d’échange, pouvait devenir une fin en soi (on peut vouloir l’argent pour l’argent); ce qui constitue une véritable perversion à ses yeux. Cette perversion de l’économie est la chrématistique (l’art de l’accumulation de la monnaie). Aristote rappelle le mythe de Midas, roi de Phrygie, qui demanda au dieu d’acquérir le pouvoir de transformer en or tout ce qu’il touche. Le roi, qui pense devenir ainsi l’homme le plus riche au monde, ne peut plus ni manger ni boire puisque dès qu’il touche un aliment, celui-ci se transforme en or.
Texte Aristote, La politique

B- Irrationalité de la nature humaine et impossibilité d’une science économique
L’homo oeconomicus est censé calculer au mieux ses intérêts de manière rationnelle. Cependant le calcul de ses propres intérêts n’est pas soumis à la raison : la rationalité se met au service de ses passions. De plus, il va être soumis à des facteurs totalement subjectifs dès lors qu’il doit à la fois savoir comment satisfaire son désir et quels sont les désirs des autres.
La loi de l’offre et de la demande va en effet faire varier la valeur des choses selon l’anticipation que chacun va avoir des désirs des autres acteurs économiques. L’économie ne peut donc pas établir d’équilibre si ces facteurs impondérables impactent sur le prix accordé aux valeurs marchandes. L’économie aurait dû être une science rationnelle, elle tente toujours de l’être, mais elle reste traversée par la subjectivité et les passions les plus extrêmes. De plus, les lois économiques existantes, permettant d’établir des pronostics, influencent les acteurs et faussent donc perpétuellement les prédictions.
Rappel : Le désir humain n’est pas fonction de nos besoins : il est fonction du désir des autres. Je désire ce que l’autre désire, je désire le désir de l’autre. Dès lors, le jeu du désir sera la « loi » fondamentale de l’échange.
C- Perversion de l’échange et dissolution du lien social
L’argent, ultime objet du désir ?
Textes Schopenhauer, Marx
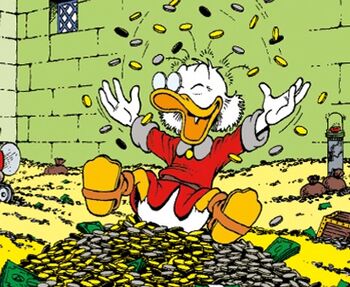
IV- Le lien social va bien au-delà du seul échange marchand
A- Aucun échange n’est seulement égoïste
« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ».
Adam Smith, Richesse des Nations
Smith met à la fois l’accent sur l’égoïsme, et sur le caractère humain de l’échange : il faut que les deux contractants se reconnaissent comme des personnes, dotés de la conscience de ce qu’ils font, donc comme des sujets moraux.
Ce qui se joue dans l’échange économique, c’est finalement aussi la nécessité d’être reconnu en tant qu’être humain, mais aussi en tant que membre à part entière d’une société. La réciprocité des échanges crée le lien social et la notion d’intérêt commun.*
L’échange n’est donc jamais seulement marchand, ou bien il se détruit lui-même.
L’égoïsme initial débouche donc sur son dépassement.
En échangeant des objets, des biens ou des services dans une relation économique, on échange aussi d’autres biens qui ont une valeur symbolique. Le moindre échange génère le système symbolique global d’une société. Ce qui circule, c’est aussi en même temps des signes, qui portent les valeurs de la société.
*Définition importante : l’intérêt commun
La notion d’intérêt commun désigne le fait que les intérêts individuels seront mieux servis si l’on les « mutualise », si l’on considère que la satisfaction des intérêts individuels nécessite de prendre en compte le développement des affaires communes. En clair : on garde comme but l’intérêt individuel, mais on le fait dépendre de la prospérité de la communauté.
Conséquence de la « main invisible » : elle tend donc vers une « mutualisation » des intérêts individuels .
Voir aussi le texte de Kant sur l’insociable sociabilité
B- Le don, entre égoïsme et acte social
Le don est-il étranger à toute forme d’intérêt égoïste ?
Le don n’est-il qu’une forme d’échange ?

On comprendra encore mieux les multiples dimensions de l’échange dans le fait social du don : ni tout à fait désintéressé, ni réductible au pur calcul.
Le don comme cadeau
Contrairement à l’échange impliquant une contrepartie, le don peut être défini à première vue comme le fait de céder à quelqu’un un bien sans attendre de retour, et donc de manière désintéressée. Seul l’intérêt du récipiendaire est visé.
Désintéressé, libre et non pas obligatoire, le don est volontaire, privé. Pacifique, il scelle des rapports d’amitié. En principe il n’implique pas de calcul, encore moins d’une visée manipulatrice. Nous disons souvent que « c’est l’intention qui compte », on entend bien souligner par ces mots que la valeur du don n’est pas monétaire, et que le calcul de sa valeur serait une entorse aux liens quasi sacrés qu’il doit tisser.
Le don, un échange déguisé?
La possibilité d’assimiler le don à l’échange peut paraître provocatrice, car l’opinion commune conçoit le don comme un geste désintéressé sans contrepartie. Pourtant, à mieux regarder le don, on y observe une certaine dimension que certains qualifieraient de « cynique ».
Ainsi, le sociologue français Marcel Mauss (1872-1950) voit dans le don une triple obligation:
- Celle de donner.
- Celle de recevoir.
- Celle de rendre.
Pas de don sans contre-don disent les anthropologues.
Un don attend généralement un retour, car il met autrui dans une situation de dette. Il n’est pas difficile de voir une logique de l’échange dans toutes les formes de don.
Mauss s’est intéressé au don dans les sociétés primitives. Il a observé dans les tribus du nord-ouest de l’Amérique du Nord la pratique du « potlatch ». Elle consiste en une obligation de donner et de rendre. Les deux partis surenchérissent dans les offrandes afin d’établir une hiérarchie: le dominant sera celui qui donnera le plus.
Mais dans le « potlatch » on ne s’échange pas seulement des biens matériels, on s’échange aussi «des politesses, des festins, des rites, des services militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes » (Mauss).
Ce constat amène à définir aussi le don comme une prestation sociale. Si le don est une forme d’échange, il ne se réduit donc pas à sa stricte dimension économique.
Conséquence :
Le don n’est pas un échange marchand, malgré certains aspecte apparentés, car il est essentiellement un acte social. Il a avant tout pour but de tisser et de renforcer constamment les liens sociaux.
C- Tout échange est symbolique , c’est cette dimension qui fonde véritablement le lien social
Lorsque l’on échange des paroles, des idées, des sentiments, on ne perd rien de ce que l’on donne. Au contraire, dans le dialogue, les pensées que l’on échange s’enrichissent mutuellement et se développent. Le résultat du dialogue est finalement beaucoup plus riche que l’addition des deux pensées initiales. Une société ne peut perdurer sans cette dimension symbolique de l’échange.
Levi-Strauss montre que l’interdit de l’inceste, fait humain fondamental et constante universelle des sociétés humaines, a pour fonction première d’obliger à l’exogamie (obligation de prendre une femme en dehors de la tribu). Cette exogamie crée des liens qui permettent à une communauté de tisser des liens solides.
L’échange est donc un fait de culture, (paroles, cadeaux, politesse, histoires…) il nous humanise : l’enfant ne peut intégrer le monde humain si l’on ne lui parle pas, si on n’échange pas avec lui, c’est cela qui l’intégrera à la communauté des hommes.

Conclusion :
Selon les théories contractualistes, le lien social est essentiellement fondé sur l’utilité réciproque. Nos sociétés sont fondées sur l’interdépendance et sur l’ égalité, principe enraciné dans le calcul des intérêts particuliers et égoïstes. Cependant le contractualisme tend peut-être à oublier les liens plus souterrains qui se tissent constamment dans les échanges non marchands, liens de partage, de solidarité et d’amitié, qui donnent au lien social sa force, sa complexité infinie et sa richesse.
